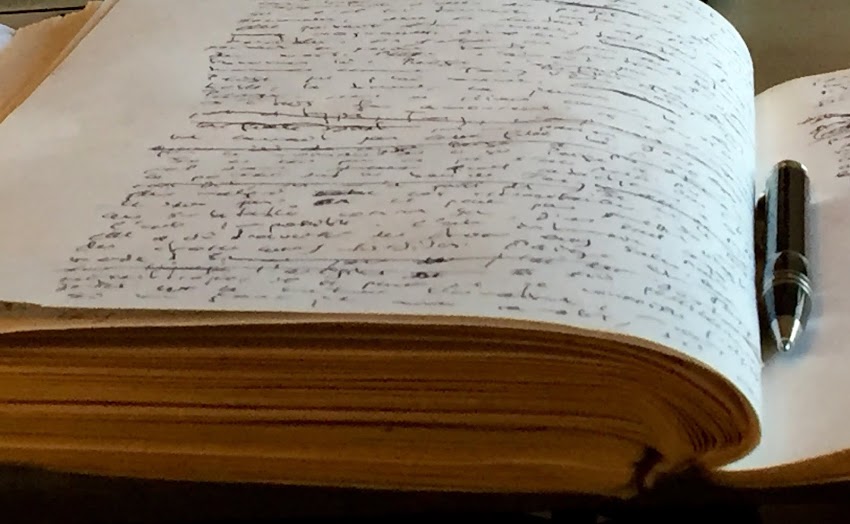Faustine, ses mots ressemblaient à la voile qui prend le vent, ils faisaient comme l’aviron qui fend la vague. C’était le même souffle, la même force. Cette fille était d’une énergie incroyable. Ses yeux étaient perçants. Son regard fouillait l’horizon.
Elle me parla de sa Terre Promise. C’était le milieu de la nuit, quelque chose comme ça. Elle voulait enseigner, plus tard, être prof à la fac. Moi, je trouvais que ça en jetait, dit comme ça. Je n’y connaissais pas grand chose, mais je trouvais que ça balançait bien. Elle en parlait comme d’un continent d’or, tout blanc, un continent vers lequel elle courrait, là-bas, où poussent les grands secrets, les grandes réponses, elle en était certaine.
Tout était limpide dans ce qu’elle disait, tout était simple, si ce n’était cette petite chose, ce petit être qui lui tournait autour, inlassablement, avec un sourire assez stupide.
Faustine n’était pas venue seule. Le petit être dans son dos, c’était sa bonne copine. Une fille quelconque, qui n’était pas jolie, qui ne cherchait pas l’être, qui ne pourrait sans doute jamais le devenir. Elle était là, dans son ombre, elle se taisait et souriait tout le temps, la bouche ouverte.
J’ai tout de suite vu de quoi il s’agissait. Les filles comme Faustine, c’est chaque fois la même chose : toujours flanquées d’une suiveuse, voire plusieurs. Invariablement. C’est une sorte de principe, comme une loi de la nature. Cet éternel cortège de laideronnes dans le sillage des gentilles sirènes, des horreurs qui cherchent à récupérer tout ce que leur nage majestueuse a laissé de côté. Elles font les poubelles, elles fouillent, elles recyclent. Elles vivent dans leur ombre, se réchauffent de leur éclat. Elles ouvrent leurs bras trop courts, tendent leurs lèvres flétries d’ennui à tous les recalés.
Tout cela ne serait pas très grave, pourrait tout autant participer à une sorte d’équilibre, à l’ordre des choses - au pire toutes ces filles ne constitueraient qu’un élément du décor - si leur jalousie secrète, la rancœur accumulée, les frustrations amoncelées sans fin ne se transformaient pas, tôt ou tard, en perfidie, en méchancetés carnassières.
Faustine dut remarquer quelque chose dans mon regard, cette méfiance que m’inspirait la petite chose, elle dut s’apercevoir que je parlais plus bas chaque fois que l’autre pointait son museau. Alors elle voulut me détromper. Cette petite chose était La Meilleure Copine*, celle qui partageait son banc de fac, celle qui lui passait généreusement ses cours quand Faustine bossait dans son collège. Les présentations furent faites. La chose opina en souriant.
La Meilleure Copine (ou l'infiniment petit)
La rencontre entre Faustine et La Meilleure Copine se fait un jour pluvieux, devant la banque de prêt de la bibliothèque universitaire. Les gens sont énervés, les jours de pluie, elle devrait le savoir, La Meilleure Copine. C’est à cause de la circulation, du retard qu’on a pris, de cette humidité qui remonte par les semelles. L’été est tellement loin derrière, tellement loin devant. Ce qu’on aimerait, c’est pouvoir dormir encore, rester sous sa couette, ne pas voir les gens. Alors, lorsqu’une La Meilleure Copine se met à insister, le menton posé sur la banque, on n’a as envie de faire des efforts. On lui répète qu’elle a dépassé son quota de prêts, qu’il lui faudra attendre. On devient désagréable, fatalement. Elle ne renonce pas. Elle devient arrogante. Elle a absolument besoin de ce bouquin. Dans une minute on va devenir odieux, les choses vont mal se passer. La Meilleure Copine est de ces gens qui ne respectent pas la fatigue des autres, leur lassitude. Les jours de pluie sont des jours comme les autres. Elle ne voit pas où est le problème. Elle ne voit pas plus loin que son nez.
Faustine, ce n’est pas pareil. Elle aime la pluie. Elle aime le jour et la nuit. L’eau et l’été. Elle assiste à la scène. Elle a reconnu cette fille. Elle partage certains de ses cours. Elle s’avance et elle pose sa carte de prêt sur le comptoir. Elle va emprunter le livre pour elle. Pour rendre service. Tout le monde sera content.
C’est comme ça qu’elles se rencontrent, comme ça qu’elles deviennent copines. Elles se retrouvent en cours. Elles se retrouvent au café.
C’est Faustine, elle insiste. La Meilleure Copine n’a jamais usé la toile de ses mauvais pantalons dans les cafés. Elle ne soupçonne rien des heures passées dans le brouhaha des pubs, des gens qui vivent, des gens qui rient debout, accoudés au comptoir, elle n’imagine pas les nuits dans la moiteur des boîtes. A quelques excursions prés - des trucs de bonne sœur - elle n’a jamais quitté son quartier. Quelques séances de cinéma, un resto le dimanche en famille, pour les grandes occasions. Faustine s’est mise en tête de la débaucher un peu. Elle aime rendre service, cette fille.
Elle a ce défaut, cette faiblesse enthousiaste d’ouvrir, de tendre une main, de donner au lieu de vendre, de temps en temps. De penser surtout que la vie peut ressembler à une fête. Qu’on peut être sérieux sans se prendre au sérieux.
Faustine est une idéaliste forcenée. On n’a pas idée d'être idéaliste à ce point.
Ce qui frappe Faustine c’est la capacité de travail de sa nouvelle copine. Elle écoute, elle lit, elle met en fiche, elle apprend, elle ingurgite et recrache tout le moment venu. Un bourreau de travail, une véritable fourmi. Faustine, dans son genre, est une abeille. Elle butine, elle cultive ses pollens. Son obsession, Faustine, s’est produire son propre miel. Elle ne veut rien recracher elle. Elle lit, elle comprend, elle assimile. Son propre miel. C’est son obsession. Quitte à s’empoisonner, de temps en temps, avec quelques auteurs pourris, des usurpateurs.
L’une est fourmi, l’autre abeille, donc. Mais il n’empêche, elles s’entendent plutôt bien. Et puis, la fourmi récolte régulièrement des notes ahurissantes. Ne pas penser, ne pas réfléchir, juste reproduire. Ça a du bon, visiblement. On ne peut que s’incliner.
La Meilleure Copine n’a pas d’autres amis. Aucun amoureux, aucune prouesse sexuelle. Dans quelques années, lorsqu’elle aura terminé ses études, lorsqu’elle disposera d’un peu d’argent, lorsque ses hormones finiront par lui demander des comptes, outrageusement, elle se rendra deux fois par an dans un club de vacances - le genre Club Med, leurs villages de célibataires, une semaine en pension complète, juste pour se faire sauter. Elle fera partie des femmes qui font ça. Se faire baiser deux fois par an dans un club de vacances, histoire de purger les mauvais instincts, de prendre sa dose. Pour le reste un sexe toy fait l’affaire. Un truc acheté par correspondance. Très décontractant. C’est déjà ça.
Quant aux menues réjouissances, elle a Faustine désormais. Les parties de piscine, les pique-niques, les fêtes, elle la suit partout. Pour apprendre à trinquer dans les pubs, avec son petit verre de cidre léger contre sa majestueuse pinte de Guiness noire. Pour tout ça, elle a Faustine. C’est déjà ça aussi.
Enfin, à l’époque des soldes, elles se lancent ensemble dans les après-midi de shopping. Le col de ses pulls se réduit progressivement, avant de disparaître. Faustine est parvenue à la convaincre, elle qui est un eu jalouse de ses seins, elle qui doit souvent tricher pour gonfler son bonnet. Elle lui apprend à se tenir droite, à dresser son menton, à rentrer ses genoux. Dans des minutes de fous rires elle lui montre comment il faut marcher, cambrer l’échine, légèrement, pour rebondir son cul. Elle lui fait acheter de vrais sous-vêtements.
La Meilleure Copine apprend, elle ingurgite, elle applique. Des garçons la regardent enfin. Dans le bruit, dans les lumières confondues des nuits de fête ils s’isolent un peu avec elle. Mais la voie de la débauche est un long chemin. Apprendre à plaire, à danser, à incliner la nuque, à sourire pour dire « peut-être », à fermer les yeux pour dire « non ». Apprendre à aimer surtout. Elle doit le faire toute seule. Et Faustine n’y peut rien. Il y a des victoires qu’il faut remporter par soi-même. Les garçons l’amènent dans un coin, mais les choses en restent là. La Meilleure Copine reste dans son coin. Plus tard elle ira au Club Med. Plus tard. En attendant, elle rentre seule, chez elle. Toute seule.
Mais bientôt La Meilleure Copine connaîtra d’autres amitiés. Ce monde abrite d’étranges rencontres. Des rencontres inattendues, improbables. Des choses tellement moches.
Emma P. O. dirige le séminaire dans lequel Faustine et La Meilleure Copine balbutient leurs recherches. De semaine en semaine, de conversation en discussion, Emma P. O. et La Meilleure Copine se lient à mesure que s’élabore le projet d’une thèse. Des étudiantes travailleuses et disciplinées, Emma P. O. en a connues déjà. Mais elle voit en elle l’enfant qu’elle n’a jamais eu, elle voit en elle la possibilité de se faire alchimiste, de transformer le plomb en or, le canard boiteux en cygne blanc. Bien sûr c’est de l’orgueil. Bien sûr. Que voulez-vous que ce soit d’autre ?
Bien sûr La meilleur Copine oubliera vite Faustine, bien sûr La Meilleure Copine ira à la capitale, elle apprendra des choses, elle régurgitera, elle reviendra avec sa grosse agrégation dans sa petite valise, bien sûr Emma P. O. fera des pieds et des mains pour que le plomb se transforme en or. La Meilleure Copine pondra une thèse en deux temps trois mouvements. N’oubliez pas, elle est une fourmi. Elle fera tout ça pendant que l’abeille mettra des années à faire son miel, son propre miel.
La Meilleure Copine pondra sa petite thèse, donc. Ils seront nombreux ceux qui diront que le résultat est médiocre, mais Emma P. O. veillera.
L’enfant prodige pourra dormir sur ses deux oreilles. Emma P. O. ne lui demandera qu’une chose : une discrétion aussi absolue que nécessaire. La Meilleure Copine acquiescera sans sourciller, elle paraphera son pacte d’allégeance. Elle obtiendra vite fait une maîtrise de conférence. Et quand le moment sera venu, quand le moment sera venu d’aider Faustine, de la soutenir dans sa longue marche vers son continent d’or blanc, quand elle pourra lui ouvrir la porte de ses rêves elle trahira, comme de bien entendu. Elle fera ça dans l’ombre. Elle restera tapie jusqu’au jour où tous les voiles tomberont. Mais elle niera tout. Elle niera tout en bloc.
Faustine sera malheureuse mais elle trouvera encore la force de vouloir lui parler, pour essayer de comprendre, de pardonner, peut-être. Mais La Meilleure Copine ne se rendra pas au rendez-vous. Elle aura un avion à prendre. Son voyage semestriel au Club Med.
Vous verrez.