On avait dit que le papier ferait l'affaire, que les choses allaient en rester là. Les livres devaient avoir des angles, les pages se tourner avec les doigts. Les mots, les idées, les genres, triés, parfaitement rangés, dans les rayonnages. Essayons, pour voir, de décoller les étiquettes.
LA pAge noire
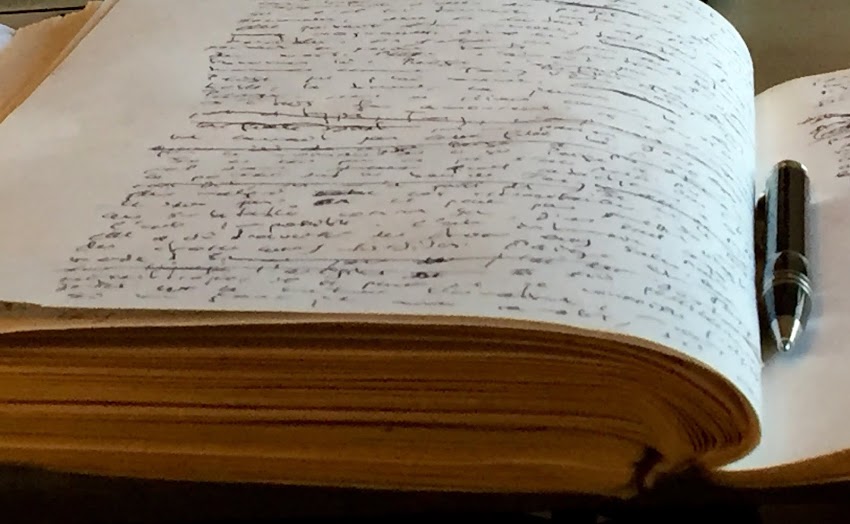
jeudi 30 mars 2017
Sourire à défaut...
Quand les imbéciles le sont davantage que ce que l'on imaginait
Quand les aveugles pensent voir dans le noir
Quand les porcs se prennent pour des divas
Quand le caniveau s'invente en prairie
Quand les gros tas rentrent le ventre
Tombent amoureux d'un miroir amincissant
Quand les miroirs se fendent
Quand les mains sales touchent l'ivoire
Quand les chauves se recoiffent
Les pitres glissent des mots d'amour
Le sauvage se déchaîne
Et quand tous les autres ne font guère mieux
Boire une Guiness
Regarder le printemps
Ecouter Miles Davis
Relire l'Eté de Camus
Serrer les dents
Sourire
A défaut de révolte
Sourire
mardi 14 mars 2017
La littérature de caniveau (ou le contre saint Proust)
Une chose est sûre, la littérature c’est du sérieux. C’est extrêmement sérieux. Il faut faire gaffe, peser chaque mot quand on en parle, quand on se targue de savoir de quoi on parle. C’est important. C’est très sérieux, je le répète. Et le pire dans tout ça, c’est qu’il faut l’être sans jamais se prendre complètement au sérieux. Un exercice difficile, périlleux.
C’est là que le bât blesse, généralement. Les gens qui parlent des livres, les gens qui commentent le style des auteurs (quand il s’agit d’auteurs, quand ces derniers ont un style), ont le plus souvent des idées précises. Regardez-les. Regardez comme ils se campent dans leur pantalon de velours, leur chemise amidonnée. Ils croisent les bras, ils bombent le torse, les muscles de la gorge se nouent, ils vont parler, ils parlent, ils ont des certitudes.
J’ai comme ça entendu dire récemment qu’il existe une littérature de caniveau. C’était asséné, c’était péremptoire, c’était convaincu, tellement convaincu. Entendons-nous bien. L’expert en Lettres qui affirmait cela ne parlait pas des imposteurs ni des cataclysmes prosaïques qui polluent les rayons des libraires et l’esprit des lecteurs, publication après publication. Ils ne parlaient des Lévy, Musso, Gounelle qui font de la littérature comme Trump, Poutine ou Kim Jung-un feraient de la politique. Non, non, pas de ceux-là. Pas de ces aligneurs de prose sans métronome, sans couleurs et surtout sans idées. Ah, je vous vois venir ! Je vous entends ! Vous allez me dire que je fais comme mes camarades bouffis de certitudes, que je vais vous dire qu’il y a effectivement une littérature de caniveau. Attendez ! On parle de littérature, d’accord ? On parle d’auteurs, de ceux qui ont une idée précise de ce qu’est un mot, une phrase, qui savent tenir le rythme. Je suis sérieux quand je parle de littérature. Ces gens-là sont délibérément à côté de la littérature. Leurs lecteurs sont à côté de la littérarité. De la lecture même.
Vous voulez que je vous raconte ? J’ai chaque fois des élèves qui boudent mon discours en début d’année, quand je débite ça. Ils ne sont pas convaincus. Vous savez ce que je leur dis ? Ecoutez les gars, laissez-moi quelques mois, laissez-moi vous montrer quelques trésors, laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne un texte littéraire, comment ça vibre une phrase écrite par un auteur, un vrai, celui qui passe trois jours sur une phrase, s’il le faut. A la fin de l’année, vous savez quoi ? A la fin de l’année je leur donne des extraits de romans. Tous anonymes. Je leur mets des pépites et de la daube. Sérieusement, vous savez quoi ? Ils lisent, ils analysent, ils prélèvent le rythme, il tentent de le justifier, ils mesurent les cadences des phrases, ils interrogent la vision du monde, les effets d’ombres et de lumières. Vous savez quoi ? Ils sont capables de dire ce qui est littéraire et ce qui ne l’est pas. Un sans faute. Ça leur a pris quelques mois. A peine quelques mois.
Bref. Revenons à nos moutons amidonnés. Revenons aux choses sérieuses, s’il-vous-plaît. De qui parlent-ils quand ils parlent de littérature de caniveau, les fins connaisseurs ?
Ils parlent des Robert McLiam Wilson, ils parlent des Philippe Djian, des Virginie Despentes, de tous ces astres-là. Leurs arguments ? Quels sont leurs arguments ? Ne vous fatiguez pas, il n’y en a pas. Vous rigolez ou quoi ? Est-ce qu’il faudrait des arguments, en plus ? De la littérature de caniveau, au seul prétexte que Proust a existé. Au seul prétexte que c’est sale, ordurier.
Alors, petite précision. Roulements de tambour.
Il a fait quoi Chrétien de Troyes ? Vous savez, le type qui a lui seul a inventé le roman moderne ? On est à la fin du 12ème siècle, le type nous dit tout de suite que le fond de l’histoire, ce qu’il appelle la matière, il s’en fout. Il nous prévient d’emblée que le sens même, il s’en contrefout. Ce qui l’intéresse, lui, c’est la conjointure (appelons ça le style, pour faire simple). Quelle est son idée géniale pour ça ? C’est de laisser tomber le latin. C’est d'écrire en roman. La langue que tout le monde entend, que tout le monde parle. La langue des vulgaires, la langue du caniveau. Okay, sa littérature c’est pour l’aristocratie. Ne vous trompez pas, Chrétien de Troyes écrit pour le seul public existant à l’époque, la seule classe qui pouvait posséder un livre. Pour les autres, pour le petit peuple, le gros populas, il y avait la chanson - qu’elle fût de gestes ou pas. Il aurait écrit pour qui, Chrétien de Troyes, au 19ème siècle ? Il aurait fait comme les Balzac et les Zola, les Goncourt qui affirmaient qu’il fallait faire descendre le roman sur le trottoir, que les temps étaient de venus de faire ça. Produire de la littérature de caniveau, avec le caniveau, pour le caniveau. Oui.
Les romans picaresques, ils font quoi d’autre ? Flaubert fait-il autre chose quand il affirme devant le frigide juge Picard : Madame Bovary, c’est moi ! Le bon Gustave a renoncé à sa littérature précieuse, ampoulée. Son style naturel, il l’a jeté au feu, il est descendu au pied du volet roulant de la pharmacie de monsieur Homais, sur le trottoir, dans toute l’âpreté de son écriture. Je ne parle même pas de cette ordure de Céline, de son Voyage, de cette exploration du bout de la nuit de l’humain. Je n’évoque pas les drôleries salaces de Rabelais et leur substantifique moelle pourtant.
Alors bien entendu il y a Proust. Ses préoccupations de bourgeois d’un autre siècle, sa petite homosexualité mal digérée, ses métonymies, ses synecdoques. On n’est pas dans le caniveau, je le conçois. On en est loin même… très loin, malheureusement pour lui, pour ses précieux lecteurs. Mais je romps là. Je ne glisserai pas, je ne ferai pas comme mes petits copains. Oui Proust est intéressant. Son œuvre cathédrale l’est. Mais Proust a fait du Proust. Tant mieux. Il a le mérite d’exister. Et tout romancier qui se respecte aujourd’hui a le devoir de ne pas faire du Proust. Il fait ce qu’il veut, pourvu qu’il continue de fréquenter le caniveau, puisque le roman c’est le caniveau. Son unique vocation est là, avec celle du rythme, de l’énergie et des mains sales.
Tout lecteur qui se respecte est prié de chercher du Proust chez Proust. Sans en faire un pendule universel. Merci.
Vive le caniveau !
Mieux en le disant.
lundi 6 mars 2017
Fac-Similé (épisode 7) ATER
Faustine a troqué ses Converse oranges contre une vraie paire de chaussures. Elle ressemble à une vraie femme comme ça, avec ses talons hauts.
Elle a décoché son concours. Elle l’a eu sans trembler, haut la main. Elle est prof, à présent, Faustine. Les contorsions douloureuses d’un chagrin d’amour, les nuits passées à pleurer, comme si la fin du monde lui tombait sur les épaules, tout ça ne l’empêche pas d’assurer ses cours à l’université. Elle prend des douches sans fin. C’est pour sentir l’eau sur son corps, pour oublier que ses yeux pleurent, inondent tout. Elle prend de très longues douches, puis elle s'en va donner ses cours.
Elle occupe un poste d’A.T.E.R.*, comme ils appellent ça. Elle a griffonné des pages et des pages. Des pages par centaines. La voilà sur le point de soutenir sa thèse. Enfin !
A.T.E.R.
Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche.
Ne tournons pas autour du pot. L’ATER est un esclave universitaire. Pour une poignée d’euros, quelques cacahuètes, il enseigne dans la Grande Maison. C’est un honneur. La chance de sa vie. Pensez donc ! il accomplit le même service qu’un maître de conférences. On lui donne le droit de faire ça. Il approche son rêve. Il l’effleure du doigt. Il s’y croit.
D’accord, d’accord, ce qu’on lui confie, ce sont les miettes, les cours que les grands seigneurs, les vassaux du cru ne veulent pas, des bouts de ficelles, des trucs ingrats, mais il y croit.
L’ATER ne se plaint pas. Il n’a pas mauvais esprit. Il est reconnaissant, infiniment. Il sait qu'il a de la chance, on le lui a dit, répété. Non, il n' a pas à se plaindre. Il aurait pu n’obtenir qu’un demi poste à l’université, et faire la manche après ses cours. C’est comme ça que l’Etat s’offre des enseignants du supérieur à petits prix. Les soldes toute l’année ! Youuupi !
On pourra rétorquer que personne ne l’oblige à accepter un emploi pareil, l’ATER. Personne ne lui place un couteau sous la gorge. Personne ne le pousse dans le dos. Mais c’est pire que ça. Le système est parfait. Impeccable même. L’esclave universitaire accepte son salaire de misère parce qu’on agite depuis le début la carotte au bout du fil. Une belle grosse carotte, juste sous ses yeux. Comme ça. On lui dit qu’avec un peu de patience, beaucoup d’abnégation, de sacrifices, de sang versé au service de la communauté, on lui assure qu’au bout du chemin il y aura le gros lot. Un poste définitif. Une maitrise de conférences. Le jeu en vaut la chandelle. Vous en conviendrez.
L’ATER s’acharne, il travaille, il courbe l’échine. Il croit toutes ces promesses. Il y croit jusqu’au bout. Jusqu’au jour où - c’est comme ça que se passe la plupart du temps - où le Comité de sélection (je vous parlerai de cette bande de joyeux drilles) le remercie en bonne et due forme, sans autre forme de procès. Les promesses ? Le pompon ? La carotte ? De quoi parlez-vous ? De quoi est-il question ? Il a dû mal comprendre, l’ATER. C’est fou comme les gens s’imaginent des choses. Ils n’entendent que ce qu’ils veulent entendre. A croire qu’ils sont un peu durs de l’oreilles, qu’ils sont même un peu légers, un peu stupides. Bref, ce qui est sûr, c’est qu’ils n’ont rien à faire à l’université, des gens comme ça.
L’ATER retourne alors dans son collège de banlieue. Cassé, brisé. De réconfort, de compassion, de repos, il n’en trouve point. Là, on lui fait payer cher son infidélité dans le supérieur. On la lui fait payer très cher. Les services du rectorat, les collègues, les syndicats. Tout le monde lui tombe dessus. On ricane, on médit. Et encore n’a-t-il pas à se plaindre. Il a un boulot, lui. Il existe des ATER qui n’ont pas eu l’immense sagesse de passer un concours de l’enseignement. Ceux-là, s’inscrivent au chômage ou servent l’Happy Hour à leurs anciens étudiants pour gagner leur vie.
L’ATER doit se montrer disponible. Il est prié d’être poli. Chacune de ses phrases doit commencer par un merci. « Pourriez-vous me remplacer le 3 décembre, je serai en Suisse pour un colloque. Vraiment, ça me gênerait d’annuler mon cours. » A cela l’ATER dit merci. « Ce colloque était parfait. J’ai invité un collègue à venir participer à notre cycle de conférences. Ce serait bien si vous y veniez avec vos étudiants. Pour faire nombre. » A cela l’ATER répond merci. « Pourriez-vous récupérer monsieur X à la gare avant votre cours ? C’est sur votre chemin. » A cela l’ATER doit dire merci. « J’ai une atroce migraine et, à dire vrai, ce monsieur X m’ennuie profondément. Je le déteste. Cela vous dérangerait de l’accompagner au restaurant après sa conférence ? Je vous fais confiance. Vous saurez représenter l’université. » A cela l’ATER se confond en mercis. « Je sors à l’instant d’une réunion, je dois à présent commencer mon cours et je n’ai pas trouvé le temps de tirer ces photocopies. Serait-ce abuser de vous si je vous demandais de me les apporter d’ici une demi heure ? » A cela l’ATER rétorque merci. Il dit encore merci lorsqu’on le charge du secrétariat d’une réunion, de faire l’accueil, servir les petits fours, faire le ménage, lustrer les voitures.
Il est arrivé que certains omettent de dire merci. Une fois. Par dépit ou par instinct de survie. Mais c’est comme s’ils venaient de frapper à la porte de l’enfer. Un coup sec et bref. Un coup qui sonne. Bien mal leur en pris. Livrés à la vindicte universitaire, traînés dans une boue dantesque, crucifiés la tête en bas, lapidés, donnés en pâture à la vermine ! Pour l’exemple.
Il y a cependant des histoires qui finissent bien. Cela arrive. Il y a bien des volcans qui s’éteignent, il y a bien des apparitions de la Vierge à l’entrée des grottes, il y a bien des amours qui ne se fanent pas. A force de mercis, de soumissions obstinées, d’humiliations consenties, certains ATER décrochent la pompon rouge qui coin-coin, parviennent enfin aux plus hautes fonctions, aux plus belles fonctions.
C’est une bonne chose. La morale est sauve. Le système est vraiment parfait.
L’ATER devient Quelqu’un. Il a le choix désormais. Il peut se souvenir du désert, de la boue, des coups de talons reçus sur le crâne. Il peut décider de polir les mœurs de la tribu. sans grande révolution. Il pourrait être un humaniste, changer le système de l’intérieur. Mais l’ancien ATER oublie tout. Le feu de l’enfer, le goût de la merde. Il oublie tout. Le siège est confortable, moelleux. Le sceptre dans ses mains est somptueux.
Il entre dans le système. Il en devient le garant. Il reproduit le modèle. Il le perpétue. Fait subir ce qu’il a subi. En pire, bien souvent.
Et vogue le bateau.
Inscription à :
Articles (Atom)


